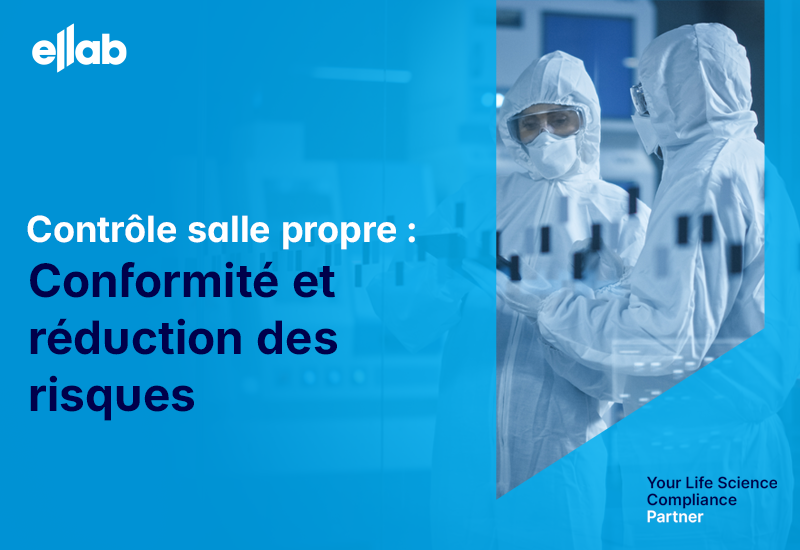Développer un cadre de gestion des risques adapté à vos opérations garantit l’efficacité et l’évolutivité des efforts de conformité. Un cadre de gestion des risques opérationnels solide comprend généralement :
1. Identification des risques
À cette étape, nous examinons attentivement tous les aspects clés susceptibles d’affecter la qualité ou la sécurité, comme la dérive d’étalonnage, les pertes de puissance, les écarts de processus ou la fatigue liée aux alarmes. Cela nous permet de garantir un fonctionnement fluide et sûr.
Des outils tels que l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) et les visites de contrôle structurées peuvent aider les équipes à identifier proactivement les vulnérabilités. L’analyse de l’historique des CAPA et des conclusions des audits met en évidence les zones à risque récurrent ou latent.
2. Évaluation des risques et priorisation
La deuxième étape consiste à évaluer la probabilité et l’impact des risques identifiés. Des outils tels que les auto-évaluations de la maîtrise des risques, les indicateurs clés de risque (ICR) et les systèmes de gestion des incidents jouent ici un rôle essentiel.
Les indicateurs clés de risque (KRI) doivent être liés à des indicateurs mesurables, tels que les temps de réponse aux alarmes, les pourcentages d’étalonnage ou la fréquence des écarts, et notés selon le modèle standard « Gravité × Occurrence × Détectabilité ». De plus, les organisations doivent définir leur appétence au risque, en précisant les risques qui nécessitent une attention immédiate et ceux qui peuvent être tolérés. Cette approche structurée garantit une hiérarchisation efficace des risques.
3. Atténuation et contrôle
Une fois les risques hiérarchisés, prenez des mesures pour mettre en œuvre des actions préventives, de détection et correctives :
- Préventif : Mesures telles que les systèmes de surveillance environnementale (EMS), les programmes d’étalonnage et l’alimentation de secours UPS.
- Détective : Alarmes, revues de piste d’audit et analyses de tendances pour identifier les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent.
- Correctif : CAPA, correctifs fournisseurs et contrôle des changements pour remédier aux écarts et renforcer la résilience future.
L’utilisation d’outils avancés comme un système de surveillance environnementale peut être un excellent moyen de détecter les conditions hors spécifications en temps réel, contribuant ainsi à alléger la charge de travail manuelle et à améliorer l’intégrité des données et la visibilité en temps réel des opérations.
4. Suivi et examen
La gestion des risques n’est pas un processus « définir et oublier » ; elle exige une surveillance continue. Établissez et suivez des indicateurs clés de performance (KPI) liés à la conformité et à la performance, tels que les délais de réponse aux alarmes, les pourcentages d’étalonnage et les taux de récurrence des CAPA. Veillez à consulter régulièrement ces indicateurs afin de rester informé des changements opérationnels et de l’évolution du paysage réglementaire. Cette surveillance proactive maintient votre programme de conformité aligné et prêt pour les audits.
5. Intégration avec les systèmes de qualité
Enfin, un cadre de gestion de l’environnement de travail (ORM) solide doit être parfaitement intégré à votre système de gestion de la qualité (SMQ) Cette intégration doit guider les décisions concernant non seulement les CAPA, les écarts, les procédures opérationnelles standard (SOP) et les formations, mais aussi le contrôle des modifications, le contrôle des documents et les processus qualité des fournisseurs. En alignant l’ORM sur les éléments du SMQ, vous créez un écosystème de conformité unifié qui garantit la connaissance des risques et la responsabilisation à l’échelle de l’ensemble de vos opérations.